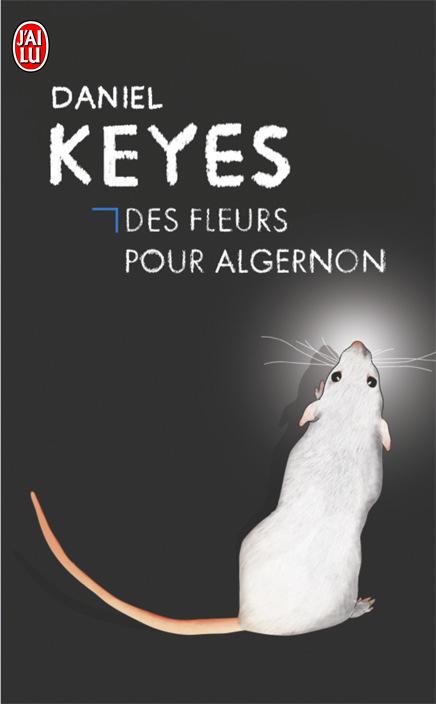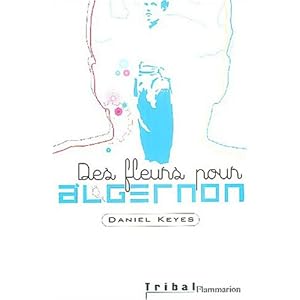Dracula...
Personnellement, je suis un peu déçue par ce classique abrégé ! Je marche peut-être sur des œufs car n'ayant pas lu la version complète, je ne peux pas fournir de preuves à l'appui, mais j'ai le sentiment d'avoir parcouru l'histoire, de l'avoir simplement survolée. D'ailleurs, je n'ai jamais pu être totalement captivée par le récit et je m'emmêlais parfois entre les personnages et leurs histoires, je pense surtout à ma confusion Jonathan Harker - John Seward qui a exigé à de nombreuses reprises la relecture des lignes précédentes ! Ceci est la preuve chez moi que je ne suis pas rentrée dans l'histoire, que je l'ai observée de haut.
En ce qui concerne Dracula et l'image du vampire, je n'ai rien appris de plus que ce que je savais déjà ! Fleurs d'ail, hostie, pieu dans le cœur et j'en passe, des éléments tellement connus à l'heure actuelle que lorsque je les lis, je les trouve clichés. Cela est sans doute dû aux nombreuses adaptations du vampire bien sûr, je ne remets pas la faute entière sur Bram Stoker, mais j'ai trouvé que cela perdait de son charme, même s'il faut remettre en contexte... Autre aspect du livre qui m'a un peu déçue : à aucun moment je n'ai ressenti de sentiment de peur, tout juste un peu de suspense de temps à autres... Ainsi, je referme ce livre sans être bouleversée !
Comme je l'ai dit plus haut, je n'ai pas lu la version complète de Dracula, mais vu ma légère frustration en refermant l'abrégé, je pense peut-être entamer la lecture du "vrai" Dracula pendant les vacances ! Alors qui sait, ce classique abrégé peut-il susciter chez les élèves le même sentiment que chez moi, et éveiller leur curiosité pour connaître tous les détails, voire finir par apprécier cette histoire ! Ce soir, je vais suivre vos conseils et regarder la version de FF Coppola (enfin, si le téléchargement se termine !), peut-être pourrai-je me faire une meilleure idée de ce vampire, à qui l'on a ôté certains traits de sa personnalité !
J'ai terminé le paragraphe précédent en parlant de traits de caractère ôtés à Dracula. Cela aussi, ça me frustre. Car si, comme je l'ai dit plus haut, j'ai retrouvé tout ce que je connaissais au sujet des vampires, il y a néanmoins un thème plus complexe selon moi qui n'est absolument pas abordé dans ce classique abrégé, il s'agit de la séduction. Le vampire a ce côté classe et séducteur, entendre "le comte Dracula" évoquait de suite chez moi cette classe qui lui était attribuée, or ici, il n'en est rien ! Pourquoi avoir complètement enlevé cette "partie" ? Je n'ai pas le sentiment qu'elle soit accessoire, car selon moi elle ajoute justement au personnage maléfique une certaine complexité, une profondeur. Non pas que je sois voyeuriste, mais tout de même ! Je sais que je me suis posée à plusieurs reprises les questions suivantes : quid des trois femmes qui vivent avec lui ? ; quid de Mina puisqu'il paraît que leur relation est bien plus fouillée ?, ... À ce sujet, je ne peux donc m'empêcher d'en vouloir à cette version, qui me donne l'impression d'avoir pratiqué la censure, pour ne pas froisser nos petits, si sensibles.
Je reste donc assez sceptique au sujet de ce récit, mais je pense que c'est surtout au classique abrégé que j'en ai ! Ainsi, je ne pense pas proposer ce type de livre à mes classes, car j'aurai le sentiment d'évincer une partie de l'histoire... Je ne sais pas s'il en va de même pour les autres classiques abrégés de l'école de loisirs, mais ici ce choix me paraît arbitraire.
En regardant sur leur site, je constate qu'ils proposent une belle liste de classiques abrégés ! Dans un sens, j'ai tendance à faire ma puriste et à dire qu'il est dommage de choisir la facilité, mais il suffit que j'observe mon propre comportement en la matière pour arrêter toute hypocrisie littéraire et admettre que si je commençais par lire toute cette liste de classiques, ce serait déjà pas mal !